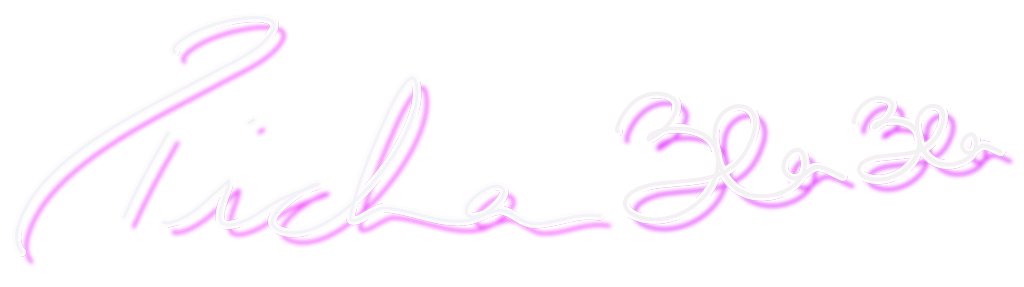Il y a bien longtemps, allongée dans mon lit d’hôpital, abrutie par les opioïdes, abrutie par le petit poste de télévision, éreintée par le bruit dans les couloirs, par les brouhaha venant des chambres voisines...la routine d'une vie qui ne m'est pas familière, que je ne considère mienne, et à laquelle on me retire petit à petit toute dignité.
Les pleurs, les suppliques, les cris, les alarmes qui retentissent jusqu'aux confins de la nuit.
Une douleur qui déforme mes traits, les chairs meurtries, un corps qui ne répond plus, des réflexes perdus, une silhouette inconnue et pourtant tout cela c'était moi, pas le moi que je connaissais, mais tout de même moi. Cette souffrance qui me faisait crisper ma mâchoire des heures durant, que je ressentais à chacun des moindres mouvements, une souffrance dont seul le sommeil me soulageait.
Mon corps à jamais changé, mon moi que je me dois de reconstruire.
Mais comment ? Mes yeux fixant le plafond, mes pensées s'embrouillent, les mots tourbillonnent dans ma tête, la médication me rends malade, la télé m’exaspère, seules les visites m'égayent ; néanmoins je reste seule face à mon problème. Dans mes tourments, sans m'en apercevoir, je change, je prends sur moi, je ne crie plus, je ne pleure plus, la douleur est devenue ma compagne de vie.
Petit à petit, je retrouve un semblant de vie.
Je me rends compte que tout ce temps alité, on a eu pu me voler ma mobilité, la souffrance a possédé ce corps qui m'était devenu étranger...et durant tout ce temps, je ne faisais que penser, durant tout ce temps, je me faisais entraîné par le flot brutal et sauvage de mes émotions. Les seules chose à être restées miennes, celle que j'ignorais avant, sont devenues les seules choses dont je suis fière aujourd'hui.
Les cicatrices que certains voient avec pitié, que d'autres voient avec douleur, sont devenues le symbole de ma liberté.

[mc4wp_form id= »140″]